
15 novembre 2021 par Jean Mermoz

15 novembre 2021 par Jean Mermoz
[ Peinture : Le Voyageur contemplant une mer de nuages – Caspar D. Friedrich 1818 ]
« Il existe probablement une énorme courbe invisible, une route stellaire, où nos voies et nos buts différents se trouvent inscrits comme de petites étapes, — élevons-nous à cette pensée ! Mais notre vie est trop courte et notre vue trop faible pour que nous puissions être plus que des amis dans le sens de cette altière possibilité ! — Et ainsi nous voulons croire à notre amitié d’étoiles, même s’il faut que nous soyons ennemis sur la terre. » ( Le gai savoir – éd. GF p.228)
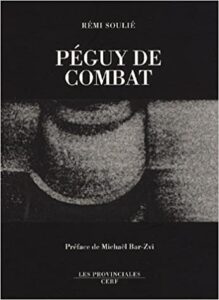 Rémi Soulié, né en 1968 en Rouergue, est philosophe et écrivain. Il a publié une quinzaine de livres dont Racination (Pierre-Guillaume de Roux, 2018), qui sera réédité en janvier prochain par les Editions de La Nouvelle Librairie, de même que sera publié, chez le même éditeur, un nouvel essai : L’Ether.
Rémi Soulié, né en 1968 en Rouergue, est philosophe et écrivain. Il a publié une quinzaine de livres dont Racination (Pierre-Guillaume de Roux, 2018), qui sera réédité en janvier prochain par les Editions de La Nouvelle Librairie, de même que sera publié, chez le même éditeur, un nouvel essai : L’Ether.
Il collabore aux revues Eléments et Le Bien commun et anime également les émissions « Le Monde de la philosophie », sur Radio Courtoisie, et « Les Idées à l’endroit », sur TV Libertés.
Cercle Jean Mermoz : Charles Péguy est l’auteur principal des irrévérencieux et courageux Cahiers de la Quinzaine, cette revue qu’il a commencé à éditer le 5 janvier 1900, et qui clôturera son dernier numéro en juillet 1914. C’est d’ailleurs de ces Cahiers dont sera issu le texte le plus connu de Péguy Notre Jeunesse.
Dès la première ligne de votre somptueux Péguy de Combat , vous écrivez “Actualité de Péguy”( Péguy de Combat p.17) avec une sorte de retenue, comme si vous commettiez un péché par l’écrit. D’ailleurs vous pardonnez directement vos potentielles offenses, dès la seconde phrase “Voilà un mot qui pourrait lui nuire”. En effet, notre époque baigne, au risque de la noyade, dans le jus pourrissant de l’actualité permanente, des journaux et de la presse. Péguy était très critique vis-à-vis du journal, le fabricant industriel de la « pensée toute faite » , prélude à « l’âme habituée » — « grimoire de mort, compendium de slogans »( Péguy de Combat p.17) selon votre belle expression. Justement, de Péguy, beaucoup connaissent cette sentence tirée des Cahiers de la Quinzaine « Homère est nouveau ce matin et rien n’est peut-être aussi vieux que le journal d’aujourd’hui. » — les œuvres inactuelles, hors du bavardage heideggerien, se télescoperaient à travers les âges et en deviendraient intemporelles. Justement, pour reprendre l’adjectif nietzschéen par excellence, Péguy est-il intempestif ? Son œuvre, relativement située dans son époque, touche-t-elle à cette intemporalité intempestive et inactuelle ?

[ Charles Péguy ]
Le « journal » est plus que jamais un torche-cul – Léon Bloy évoquait une métaphysique torcheculative, qu’il opposait à la spéculative, chrétienne. Pour le coup, la « métaphysique », fût-elle torcheculative, est de trop : la prière matinale hégélienne s’adresse à Satan ou à l’un de ses nombreux desservants (je m’empresse de préciser que les « Litanies de Satan » de Baudelaire relèvent d’un tout autre domaine). L’unique « journal » du Parti unique, dupliqué – sur le mode du simulacre – en plusieurs titres, tend plus que jamais au dressage disciplinaire. Bientôt, les hommes libres pourront se compter. L’ « information », par une ruse elle-même diabolique, est devenue l’antonyme de la formation (de la paideia aussi bien) afin de nier toute forme, toute Idée. Là encore, Péguy et Nietzsche sont bien plus proches que l’on pourrait le penser de prime abord : « Encore un siècle de journalisme, écrit Nietzsche, et les mots pueront ». Nous y sommes.
CJM : Plaidons pour un éclairage nietzschéen sur l’œuvre de Péguy (et inversement d’ailleurs, ce sont des amitiés stellaires, selon la formidable expression de Nietzsche, leurs intuitions étincelantes sont comme des balles traçantes : elle illumine le même ciel français et européen). Leurs écrits sur l’in-forme monde moderne, décapité de tous ses ferments d’ordre et de désordre, se recoupent admirablement – « Aussitôt après nous commence le monde que nous avons nommé, que nous ne cesserons pas de nommer le monde moderne. Le monde qui fait le malin. Le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n’en remontre pas, de ceux à qui on n’en fait pas accroire. Le monde de ceux à qui on n’a plus rien à apprendre. Le monde de ceux qui font le malin » (Notre Jeunesse – éd. Folio p.102). Cette figure du malin devenu « l’imbécile » chez Bernanos, (autre auteur de cette divine constellation des «Anti-Modernes ») résonne poétiquement et philosophiquement avec le dernier homme du prologue du Zarathoustra, qui sautille joyeusement sur le cadavre mort de tous les autres mondes, grec et latin, païen et chrétien – «Jadis, tout le monde était fou, diront les plus malins, en clignant de l’œil.» On sera malin, on saura tout ce qui s’est passé jadis ; ainsi l’on aura de quoi se gausser sans fin. » (Ainsi parlait, Zarathoustra – éd. GF p.53) Leurs vues perçantes sur la radicale nouveauté du monde moderne convergent, mais comment pensent-ils respectivement l’avènement de ce dernier homme, si malignement imbécile ?
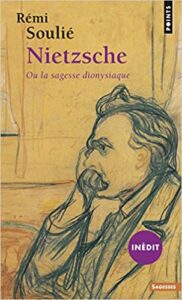
Rémi Soulié : À partir de ce que Nietzsche appelle « la mort de Dieu », qui constitue un ébranlement dont les secousses et les répliques n’ont pas cessé depuis cette annonce qui, en un sens, constitue une « mauvaise nouvelle » comme l’Évangile en était, littéralement au moins, une bonne. Certes, pour Nietzsche, cette nouvelle de la « mort de Dieu » peut être bonne, bien meilleure que celle de l’Évangile – qui en était aussi, à ses yeux, une mauvaise – en ce qu’elle peut être une chance pour l’avènement du Surhomme préparé par les « esprit libres », mais elle est tout autant un risque, celui du nihilisme, que nous devons encourir et affronter – celui, en tout cas, du « nihilisme actif », le « nihilisme passif » étant pathologique (c’est hélas celui-ci qui triomphe avec l’avènement du « dernier homme », le règne du Surhomme se faisant attendre autant, si l’on ose dire, que la Parousie).
Contrairement aux apparences, il n’en va pas très différemment pour Péguy : certes, pour lui, Dieu n’est pas mort, bien au contraire, mais pour lui seulement ou d’autres écrivains de sa génération, le plus souvent « convertis ». Péguy, en effet, perçoit à quel point le monde moderne est celui de « ceux qui ne croient en rien », c’est-à-dire, qui croient dans le rien ; il perçoit à quel point ce n’est pas l’Évangile selon Zarathoustra qui a supplanté l’Évangile (sauf pour Drieu et quelques autres, qui l’emportent dans leur paquetage de soldat) ou le Satyricon de Pétrone, comme en rêve un Nietzsche rieur, mais le livret de Caisse d’épargne. Où l’Antéchrist de Nietzsche pulvérise le « paulinisme » à coups de marteaux en vue d’une nouvelle Aurore, l’antéchrist moderne, le dernier homme, calcule petitement (« Je gère » est l’une des scies qu’il préfère). Le chameau ne s’est pas métamorphosé en lion, puis, en enfant mais en cancrelat kafkaïen, en fourmi, selon René Daumal, en robot, selon Bernanos. Une fois encore : nous y sommes (il ne fait évidemment aucun doute que les grands poètes sont des visionnaires).
Le sérieux caractérise également Nietzsche et Péguy sur le plan, il est vrai inférieur, de la psychologie – ce qui n’empêche pas le premier de rire et de pratiquer, parfois, l’ironie voltairienne, alors que le second ne rit guère et n’ironise pas du tout, mais ils ont tous deux le sens de la gravité : ce qui se joue est tragiquement décisif.
Le « malin » à qui l’on n’en fait pas « accroire » mais qui croit donc au rien, le « dernier homme », l’ « imbécile » (ou l’ « intellectuel » qui, pour Bernanos, en est l’une des désincarnations) sont autant d’hypostases de celui que nous appelons aujourd’hui « homo festivus » (Philippe Muray, bien sûr), soit, le démocrate progressiste (pléonasme). Je suppose qu’il est inutile de le décrire : ceux qui n’ont pas dans leur bibliothèque les œuvres de Nietzsche et de Péguy ont sans doute un téléviseur, où il doit apparaître en gloire et en majesté à chaque heure du jour et de la nuit (on a les épiphanies que l’on peut). Il coche toutes les cases de la « merdonité » (Jean Chesnaux) et se contre-extasie de se croire au paradis alors qu’il est en enfer – encore est-ce lui faire trop d’honneur que d’utiliser ce vocabulaire tant le démocrate est tiède : disons, plutôt, qu’il ronronne de plaisir ou qu’il piaille de douleur en attendant la pâtée, y compris au sens argotique de ce mot (d’ailleurs, cet an-ci, il en redemande tant son désir de servitude est puissant). Nous assistons en effet à une entreprise de domestication inouïe, mâtinée de dressage – à la chinoise. Le « capitalisme de surveillance », contre-Assomption de la mondialisation, relève de la magie noire, de l’envoûtement. C’est prodigieux.
Bien entendu, nous devons nous tenir auprès de l’enfant qui joue d’Héraclite ou de la petite fille Espérance de Péguy, cette fraternité ou cette sororité-là demeurant, si invisible soit-elle, en amont et en aval de la contrefaçon républicaine, de cette Fraternité lugubre, spectrale, bestiale et ténébreuse. Nietzsche, en effet, l’appelait « amitié stellaire », et il faut toujours saluer les constellations.
CJM : Nietzsche ne manquerait pas de lui rappeler, selon votre formule « qu’il est un cul-terreux, un cul-de-plomb sédentaire et pérégrin » (Péguy de Combat p.18). On se souvient que Nietzsche, du haut de sa sublime ironie, tempêtait contre les culs-vissées et les esprits alourdis — « Rester assis le moins possible ; n’accorder foi à aucune pensée qui ne soit née en plein air et en prenant librement du mouvement, — où les muscles ne fassent également la fête. Tous les préjugés viennent des tripes. — Le cul-de-plomb — je l’ai déjà dit — c’est le véritable péché contre l’Esprit saint. » (Ecce Homo – éd. p.74 ) Peut-être est-ce là, sur les cimes de la pensée dansante et dionysiaque, que se situe une des différences majeures entre nos deux penseurs. En effet, malgré l’invitation de Zarathoustra à demeurer « fidèles à la terre », (Ainsi parlait, Zarathoustra – éd. GF p.48 ) Nietzsche est moins sensible aux vertus de l’enracinement tellurien, charnel et « terreux » selon le mot de Péguy. On imagine assez mal le prince de Sils Maria être décrit en ces termes : « Son pays de pensée, de parole et de langage, est tout entier contenu dans une « maison de paysan », « une de ces fermes de Beauce » dont le fondement — ab urbe condita, depuis la fondation de la ville est sacré. » (Péguy de Combat p.88) L’enracinement et ses « besoins de l’âme », si magnifiquement explorés par Simone Weil (que vous rapprochez de Péguy, notamment autour de cette question principielle p.63 ) ne sont-ils pas la part-délaissé, le chaînon manquant de le pensée de Nietzsche ?
Rémi Soulié : C’est en effet un point de bascule, parmi d’autres, mais que j’aurais en l’occurrence tendance à relativiser car Péguy est lui aussi un marcheur, un miles, un fantassin, un arpenteur. Combien de fois a-t-il fait, à pied, le chemin qui sépare Lozère de Paris, sans parler du pèlerinage de Chartres et de ses pérégrinations dans le Quartier latin ? Je possède un très joli petit carnet où il notait ses dépenses et ses courses – au sens alimentaire et pédestre – très minutieusement, au crayon à papier : il dessinait de petits plans : « Bures, Orsay, Saclay, Jouy-en-Josas… ». Néanmoins, il est vrai que son périmètre est beaucoup plus réduit que celui de Nietzsche – il est circonscrit, grossièrement, entre la Beauce et la Brie – et, surtout, que sa philosophie et sa pratique de la marche diffèrent de celles de Nietzsche, que vous avez pour une part décrites : lui n’a que faire de voyager, du sud, de la lumière, du soleil, du haut des cimes évoliennes, de la diététique méditerranéenne et de Carmen. C’est une question d’éthique, donc, d’ethos, donc, d’habitation. Sous l’angle corporel, dans l’acception nietzschéenne – où le corps pense – les deux hommes sont des ascètes (Nietzsche n’aurait pas apprécié d’être qualifié ainsi mais, dans les faits, il l’est, pour des raisons essentiellement physiologiques et psychologiques) mais qui habitent des univers mentaux différents : Péguy est un paysan qui laboure, comme en attestent le rythme et la cadence de sa prose et de ses vers ; il se situe du côté de l’élément terre. Nietzsche est un musicien qui compose ; il se situe du côté de l’élément air (l’aigle de Zarathoustra, dont on ne doit d’ailleurs pas oublier que le serpent, animal chtonien, est enroulé à son cou, en ami, comme un collier).

[ Friedrich Nietzsche ]
CJM : Nietzsche comme Péguy partagent le même scepticisme vis-à-vis du système démocratique; Pour Péguy, « la parlementarite », « la concurrencite », « l’autoritarite », « l’unitarite », « l’électoralâtrie » viennent s’achever dans un « affreux système démocratique » (Péguy de Combat p.66-67 ). Péguy plaide pour le peuple charnel et réel, contre la démocratie « c’est que d’être peuple, il n’y à encore que ça qui permettent de n’être pas démocrate » (Péguy de Combat p.67 ). Ce système comptable et théâtrocratique, (vous citez Péguy qui parle du « gouvernement des théâtreux ») a également recueilli les foudres de Nietzsche – « Nous qui confessons une autre foi —, nous qui tenons le mouvement démocratique non seulement pour une forme de décadence de l’organisation politique, mais une forme de décadence, c’est à dire de rapetissement de l’homme, sa chute dans la médiocrité, et l’abaissement de sa valeur : à quoi devrons nous avoir recours, avec nos espérances ? — À des philosophes nouveaux, il n’y a pas d’autre choix » (Par-delà bien et mal – éd. GF p. 161 ) Leur vues convergent-elles dans ce formidable oxymore, ô combien rempli de nos espérances, d’aristocratie pour le peuple ?
Rémi Soulié : Leur convergence est en fait partielle. Les critiques nietzschéenne et péguyste de la démocratie sont radicales et, à mes yeux, parfaitement fondées mais elles n’ont pas le même sens.
Du côté de Nietzsche, la démocratie est en effet le gouvernement des médiocres. Elle est l’expression politique d’une chute dans une forme d’égalitarisme arithmétique (non géométrique) et juridique qui est la négation de tout aristocratisme hiérarchique (sur un plan anecdotique, nous constatons à quel point elle assure immanquablement la promotion des plus nuls) ; elle détruit méthodiquement les meilleurs en interdisant leur émergence même ; elle proscrit l’individualité géniale et héroïque au bénéfice de ce que Nietzsche appelle « le troupeau ». Sa définition du libéralisme, donc, de la démocratie libérale, est d’ailleurs remarquable : « abêtissement par troupeau ». Nous retrouvons le processus d’animalisation, de « bestialisation », que j’ai déjà pointé. La « bête blonde » est pourchassée, supplantée par les ânes et les oies.
Quel est, dès lors, le berger de ce troupeau qui, à la fois, se cache et se dévoile dans l’État mondial profond et total (Nietzsche a fort bien vu que le libéralisme implique l’État autoritaire, contrairement à ce qu’assurent les théoriciens du libéralisme et comme nous le voyons de plus en plus aujourd’hui à l’échelle planétaire) ? Non le « berger de l’Être » heideggérien que, par une inversion accusatoire, les libéraux font passer pour un Führer – ce qui est impossible en raison même de l’ « ouverture » du Dasein (qui est l’authentique ouverture, celle que la « société ouverte » singe et parodie), mais « le plus froid des monstres froids », glacé comme l’Enfer de Dante et le diable qui y trône. Peu importe son nom, il est Légion : État, Antéchrist, Mammon, Baal, Azazel… Je suis frappé de voir combien un Justin Trudeau, un Emmanuel (ce prénom… « Dieu avec nous »…) Macron ou un Gabriel (ce prénom archangélique !) Attal ont des visages de gendres idéaux à qui donner le Bon Dieu sans confession. A ce propos, il faut lire Le Maître de la terre : la crise des derniers temps, de Robert-Hugh Benson, en complément de l’Apocalypse de S. Jean (pour s’en tenir à notre aire et à notre ère ; sinon, lisez les Védas ou le Corpus Hermeticum, c’est du pareil au même). Il faut être attentif aux signes des temps et aux signes tout court : le Nouvel Ordre Mondial, c’est le N.O.M. Le Nom de « qui », me direz-vous ? Non celui que les crétins antisémites [1] (Nietzsche a raison) et leurs homologues « démocrates » croient déceler (« Qui ? »), mais l’inversion démoniaque du Nom biblique, Hachem. Les Juifs « qui ne trichent pas », pour citer Péguy, les Juifs qui étudient, les Juifs « mystiques » et non « politiques », le savent parfaitement, comme le savent les chrétiens et les francs-maçons « qui ne trichent pas » (mais ils sont désormais le tout petit nombre ; sans doute tiendraient-ils non dans une cabine téléphonique mais dans la boutique des Cahiers de la Quinzaine ; électoralement, sur le plan comptable, donc, qui est la seule aune – quantitative – moderne, c’est mal parti).
Du côté de Péguy, précisément, le souci ou le soin du peuple (authentique pastoralisme platonicien – c’est le dieu qui paît lui-même le troupeau dont le troupeau précédent est la parodie contre-initiatique, typiquement moderne) est total. La démocratie est un marché de dupes qui repose sur une confiscation et qui consiste à troquer des libertés réelles pour une illusoire et abstraite souveraineté générale. Dans un régime non démocratique, qu’il soit républicain ou royal (ce qui, pour Péguy, revient au même – voyez Maurras et les « républiques de France »), « Charbonnier est maître chez soi » (le paysan est seigneur) ; dans un régime démocratique libéral, il est serf de Mammon. Le « travail » – Péguy est socialiste, quoiqu’en un sens bien particulier qui n’a de surcroît rien à voir avec « nos » misérables socialistes – n’y est plus « œuvre » (je renvoie, ici, à Guénon) mais aliénation (je renvoie, ici, à Marx). Voilà pourquoi, dans l’ancienne France, les ouvriers chantent et, dans la France moderne, se lamentent (notez que, même en troupeau guesdien, ils ne chantent guère plus « L’Internationale » – même le brave Fabien Roussel entonne « La Multinationale » de ses maîtres, comme tout le monde ; le pass « sanitaire » s’applique à la Fête de l’Humanité [2] comme au Vatican, ce qui est logique – le diable est logicien, c’est un truisme de le dire). Je conseille donc une profonde méditation des Élégies de Duino et un vigoureux tirage de chasse sur tout le reste.
dans un régime démocratique libéral, il est serf de Mammon. Le « travail » – Péguy est socialiste, quoiqu’en un sens bien particulier qui n’a de surcroît rien à voir avec « nos » misérables socialistes – n’y est plus « œuvre » (je renvoie, ici, à Guénon) mais aliénation (je renvoie, ici, à Marx). Voilà pourquoi, dans l’ancienne France, les ouvriers chantent et, dans la France moderne, se lamentent (notez que, même en troupeau guesdien, ils ne chantent guère plus « L’Internationale » – même le brave Fabien Roussel entonne « La Multinationale » de ses maîtres, comme tout le monde ; le pass « sanitaire » s’applique à la Fête de l’Humanité [2] comme au Vatican, ce qui est logique – le diable est logicien, c’est un truisme de le dire). Je conseille donc une profonde méditation des Élégies de Duino et un vigoureux tirage de chasse sur tout le reste.
CJM : Nietzsche s’est penché avec passion et profondeur sur l’art, dont il nous à légué cette merveilleuse sentence « Nous avons l’art afin de ne pas mourir de la vérité ». Nietzsche sonda généalogiquement l’insupportable poids de la vérité, notamment, comme vous le rappelez, en enroulant sa pensée autour de la « figure tutélaire de Dionysos [qui] est à l’alpha et à l’oméga de l’œuvre nietzschéen » (Nietzsche ou la sagesse dionysiaque p.43). — L’implacable Péguy affirmateur, qui s’est particulièrement illustré dans sa Lettre du provincial – « Dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste », trouve son complément dionysiaque et dansant dans la gaya sΙcienza nietzschéenne « Ce que l’on doit apprendre des artistes — De quels moyens disposons-nous pour nous rendre les choses belles, attirantes, désirables lorsqu’elles ne le sont pas ? — et je suis d’avis qu’elle ne le sont jamais en soi ! » (Le Gai savoir – éd. GF Flammarion p.244 . Péguy a-t-il développé́ une pensée analogue sur l’esthétique, et plus largement, sur l’insoutenable fardeau d’une vérité « ennuyeuse » et « triste » ?
Rémi Soulié : Les points de vue – au sens presque littéral – sont très différents et très éloquents.
La « vérité » selon Nietzsche est une a-alètheia ou une « lètheia », si j’ose dire, soit, un voilement, un oubli (on comprendrait aussi fort bien par ce biais la lecture critique de Heidegger) – Nietzsche fait d’ailleurs de l’oubli une vertu, qu’il oppose au pardon chrétien, à mon sens à raison. La « vérité » est une illusion cultivée par les prêtres socratiques et chrétiens, les faibles qui refusent de voir le chaos et de le recouvrir de beauté(s), comme surent le faire les Grecs. C’est une sécrétion des têtes et bêtes humaines, au même titre que la causalité, la « science » ou la grammaire, qui rend la plupart d’entre elles inapte à la sur-humanité puisque ce sont autant de barrières que les malades se refusent à abattre par peur d’une tragédie sans autre rédemption ou solution que son terme « naturel » : la catastrophe, la joyeuse apocalypse de la lacération et du démembrement (sur le versant Georg Trakl, grand lecteur de Nietzsche, la triste putréfaction). Tu parles d’un corps glorieux ! Nietzsche évoque certes l’éternel retour mais comme un test, un critère d’acceptation ou de refus de ce que l’on ose à peine dire « ce qui est ». L’art constitue également une telle barrière, mais qui se sait illusoire, ce qui change tout.
La « vérité » selon Péguy demeure la veritas latine, aussi bien, romaine catholique. Péguy n’a rien de dionysiaque. La vérité selon le chroniqueur, à laquelle vous faites allusion, repose autant sur la fameuse adequatio rei et intellectus (il faut toujours, ici, parler latin) que chez S. Thomas d’Aquin (encore un Romain), dont la plénitude s’épanouit, comme la Rose, dans la figure du Christ. Nous sommes donc aux antipodes (ce qui ne signifie d’ailleurs pas, de mon propre point de vue, que les antipodes ne puissent converger et s’abolir en hauteur, mais c’est une autre question – je pense que ce sont les antipodes qui sont une illusion, la lila de Maya ; d’où ma comparaison avec la Rose, qui est aussi une couleur mais sans pourquoi ; il faudrait, ici en appeler à W.B. Yeats et, bien sûr, à Angelus Silesius, entre cent autres !).

[J.P Laurens : Portrait de Charles Péguy 1908 ]
Hors psychologie, le « sérieux » de Péguy diffère donc de celui de Nietzsche comme celui du Christ de celui de Zeus : la rédemption est une affaire trop sérieuse pour en rire ; l’Olympe se gondole, si j’ose dire, dès que l’occasion se présente – d’où la philosophie nietzschéenne du rire. Voyez le traitement de l’adultère par Arès, Aphrodite, Zeus, Héphaïstos ; voyez les tortures de Péguy face à la même possibilité : clous, tenailles, marteau, couronne d’épines, haire, cilice, discipline. Péguy n’est pas du tout un « immoraliste » nietzschéo-gidien.
CJM : « Il avait cette idée que sa prose, toute bonne qu’elle fût, ne valait pas ses vers », ainsi parlait André Suarès de Charles Péguy, ce « Carlyle de la France, infiniment meilleur que l’autre, plus vrai, plus libre et plus humain ». Malheureusement oblitéré par l’immense succès de Notre Jeunesse, l’œuvre poétique de Péguy est pourtant admirable. Sa poésie paysanne ignorait les demi-mesures et la prudence — la pesanteur terreuse et la grâce poétique unifié afin « d’assurer aux paroles Une perpétuité́ éternelle, une perpétuité charnelle, Une perpétuité nourrie de viande de graisse et de sang » (Le Porche du mystère la deuxième vertu – éd. Gallimard 1941 – p.110 ). Ce souci de la parole sacrée, loin de la parole viciée pour emprunter la formule de Juan Asensio, est également partagé par Nietzsche, notamment dans ses œuvres poétiques. Sa poésie, composée de chant lyriques et d’esquisses sentencielles, se déprend progressivement d’un certain romantisme plaintif hérité de Hölderlin pour venir s’achever dans une forme unique, alliant la virtuosité de l’épigramme aérien, au chant affirmateur et dionysiaque – une « antithèse ironique » selon ses propres mots.
D’ailleurs, au détour d’un de ses derniers fragments, se trouve une de ces pensées éclair, qui ramasse et comprime l’intégralité́ de l’œuvre de Nietzsche — « Débris d’étoiles, de ces débris j’ai bâti un univers ». (Poèmes 1858-1888 – éd. Gallimard – p.200 ). Péguy comme Nietzsche pensait-il comme Rimbaud, que la poésie et son chant étaient la seule forme capable de « tenir le pas gagné » ?
Rémi Soulié : Je n’en suis pas certain tant la louange de Péguy est directement religieuse et que la forme ultime à laquelle il aspire est celle qu’a prise le Dieu chrétien. La tenue du « pas gagné », pour Péguy, est l’œuvre du soldat et de la prière, au sens le plus confessionnel du terme, non celle du poème. Je ne suis pas du tout certain non plus que tout poème doive être « rabattu » ou « ramené » à la prière dès lors que le poème est moins une adresse à l’Autre que de l’Autre – évidemment pas au sens de Levinas – ou à l’Être que de l’Être, au sens heideggérien, ce par quoi il échappe radicalement au bavardage et à l’« universel reportage ». De ce point de vue – mais je reconnais volontiers que je suis un extrémissse (sic), comme dirait Céline – le néant mallarméen ou l’intellect valéryen sont tout aussi poétiques que la « prière péguyste ». Cela n’ôte évidemment rien à la poésie de Péguy – ce serait du crétinisme aggravé que de le prétendre : cela signifie que, pour lui, la Parole qui parle et à qui parler est le Verbe et non « la maison de l’être » (Heidegger), « abri » dans lequel habite l’homme et sur lequel veillent le poète et le penseur. En d’autres termes, la Révélation n’est pas le dévoilement (pour Mallarmé et Valéry, tout ceci relève bien sûr de la pure fiction…fiction qui est toutefois loin d’être « insensée » ou dépourvue d’être). C’est pourquoi Péguy nomme le « Saint » (celui de la paroisse, les Saints Innocents, sainte Jeanne d’Arc, sainte Geneviève, etc.) et, pour parler comme Heidegger une fois de plus, ne nomme pas le « Sacré » (la terre de la patrie n’est « sacrée » que circonstantiellement et en un tout autre sens). La ligne Hölderlin-Nietzsche-Rimbaud n’est pas la ligne Péguy – mais elle pourrait être, pour une part très relative, la ligne Claudel.
Il n’en reste pas moins que Péguy a le dernier mot, en son verbe :
« Etoile de la mer voici la lourde nappe
Et la profonde houle et l’océan des blés
Et la mouvante écume et nos greniers comblés,
Voici votre regard sur cette immense chape… ».
Propos recueillis par Camarade Henri
Notes :