
3 décembre 2021 par Jean Mermoz

3 décembre 2021 par Jean Mermoz
[ Peinture : Les Romains de la décadence Thomas Couture- 1847 ]
« Vous vivez lâchement, sans rêve, sans dessein,
Plus vieux, plus décrépits que la terre inféconde,
Châtrés dès le berceau par le siècle assassin
De toute passion vigoureuse et profonde. »
« Aux Modernes » – Leconte de Lisle
 Pierre Mari est un écrivain français né à Mostaganem (Algérie) en 1956. Auteur de plusieurs ouvrages sur la Renaissance, Pantagruel-Gargantua (PUF, 1994) et Humanisme et Renaissance (Ellipses, 2000), il a également publié des romans fort remarqués : Les Grands Jours (Fayard, 2013, Prix de l’Armée de Terre Erwan Bergot), Les sommets du monde (Fayard, 2017). Nous le recevons pour son avant-dernier ouvrage paru, En pays défait, (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2019), qui se présente comme « une lettre ouverte adressée aux élites françaises ».
Pierre Mari est un écrivain français né à Mostaganem (Algérie) en 1956. Auteur de plusieurs ouvrages sur la Renaissance, Pantagruel-Gargantua (PUF, 1994) et Humanisme et Renaissance (Ellipses, 2000), il a également publié des romans fort remarqués : Les Grands Jours (Fayard, 2013, Prix de l’Armée de Terre Erwan Bergot), Les sommets du monde (Fayard, 2017). Nous le recevons pour son avant-dernier ouvrage paru, En pays défait, (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2019), qui se présente comme « une lettre ouverte adressée aux élites françaises ».
[ Cet entretien est la première partie d’un long entretien que nous réalisons à l’occasion de la parution de Contrecoeur – Chronique d’une France sans lettres paru en novembre 2021 aux éditions La nouvelle Librairie.]
Cercle Jean Mermoz : En épigraphe de votre livre vous citez Gustave Flaubert : “La France a la rage de l’abaissement moral”. Pourtant, au fil de votre livre, vous désignez des élites qui ne souffrent aucunement, au contraire elles se roulent avec délice dans les “tressautements de la foire globalisé, au point d’en oublier tout ce qui pouvait ressembler à un rythme intérieur » (p.26). La décadence intérieure des élites constitue-t-elle pour vous le prélude à l’effondrement d’une Nation ?
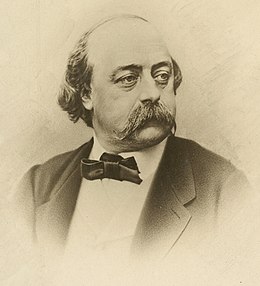 Pierre Mari : L’actualité de la formule de Flaubert n’en finit plus de s’exacerber. C’est d’ailleurs le cas de toutes ces formules meurtrières proférées durant la seconde moitié du XIXe siècle par Baudelaire, Nietzsche, ou l’auteur de Madame Bovary dans sa correspondance : leur pertinence se vérifie aujourd’hui à un degré que leurs auteurs n’auraient pu imaginer. La rage de l’abaissement qui saisit les élites – politiques, culturelles, médiatiques, intellectuelles –, nous la connaissons depuis des années, et encore plus depuis quelques mois. La pandémie lui a donné un coup d’accélérateur, comme si les conditions inédites auxquelles nous sommes soumis avaient libéré un surcroît de rage, qui déboule quotidiennement sur la place publique, de la façon la plus décomplexée et la plus obscène. Je n’ai employé le mot « élite », dans ce livre, que par antiphrase. N’oublions pas en effet que « l’élite », au sens premier, c’est ce qu’il y a de meilleur, ce que notre cœur, notre âme ou notre esprit a « élu ». Je regrette que cette étymologie, dans la perception commune, ait fini par s’émousser, voire s’évaporer : il faut lui rendre tous ses droits. Nos « élites » ne sont plus « élues », que ce soit par une procédure électorale ou un élan intérieur. C’est pourquoi j’ai préféré, autant que possible, parler dans mon livre des « visibles » ou des « importants » : ceux chez qui l’acharnement à devenir visibles, et à soutenir sur le marché le cours de leur importance, est devenu un travail à plein temps. Au fond, le mécanisme est d’une simplicité presque déprimante, et vaut aussi bien pour la classe politique que pour les écrivains ou les artistes qui occupent le devant de la scène (pas de différence, de ce point de vue, entre les deux Emmanuel les plus célèbres de France, Macron et Carrère) : quand toute votre énergie se dissipe dans cette frénésie de visibilité – c’est-à-dire de mise en adéquation de vous-même avec la médiocrité et la vulgarité ambiantes –, il ne vous reste plus une once de sérieux à consacrer au cœur même de votre tâche. Si vous aviez au départ un peu de poids et d’envergure, il ne résistera pas à ce broyage. Même ceux qui ne sont pas nuls se retrouvent à court ou à moyen terme nullifiés. A mes yeux, c’est l’alpha et l’oméga de ce que vous appelez « décadence intérieure des élites » : ces gens-là ne travaillent plus qu’à leur propre visibilité pornographique, hors de tout bon sens, de tout aiguillon du réel et de toute norme morale. Pour répondre à votre question, ce n’est pas le « prélude » à l’effondrement : c’est l’effondrement, ni plus ni moins. Tout simplement parce qu’une société ne peut pas tenir sans ce mouvement intérieur qui nous fait nous reconnaître – avec, cela va sans dire, toutes les réserves, toutes les réticences, toutes les demi-adhésions et les contestations possibles – dans ceux qui occupent les premières places. Je vais vous livrer un souvenir qui reste très fort en moi. Ma famille, arrivée en France au moment de l’indépendance algérienne, avait toutes sortes de raisons d’en vouloir aux hypocrisies, volte-face et mensonges gaulliens. J’ai parfois entendu des anathèmes très épicés. N’empêche que les discours du général étaient fidèlement suivis sur l’écran de nos télévisions encore balbutiantes. Imaginez-vous, aujourd’hui, une pareille coexistence de la détestation et du respect ?
Pierre Mari : L’actualité de la formule de Flaubert n’en finit plus de s’exacerber. C’est d’ailleurs le cas de toutes ces formules meurtrières proférées durant la seconde moitié du XIXe siècle par Baudelaire, Nietzsche, ou l’auteur de Madame Bovary dans sa correspondance : leur pertinence se vérifie aujourd’hui à un degré que leurs auteurs n’auraient pu imaginer. La rage de l’abaissement qui saisit les élites – politiques, culturelles, médiatiques, intellectuelles –, nous la connaissons depuis des années, et encore plus depuis quelques mois. La pandémie lui a donné un coup d’accélérateur, comme si les conditions inédites auxquelles nous sommes soumis avaient libéré un surcroît de rage, qui déboule quotidiennement sur la place publique, de la façon la plus décomplexée et la plus obscène. Je n’ai employé le mot « élite », dans ce livre, que par antiphrase. N’oublions pas en effet que « l’élite », au sens premier, c’est ce qu’il y a de meilleur, ce que notre cœur, notre âme ou notre esprit a « élu ». Je regrette que cette étymologie, dans la perception commune, ait fini par s’émousser, voire s’évaporer : il faut lui rendre tous ses droits. Nos « élites » ne sont plus « élues », que ce soit par une procédure électorale ou un élan intérieur. C’est pourquoi j’ai préféré, autant que possible, parler dans mon livre des « visibles » ou des « importants » : ceux chez qui l’acharnement à devenir visibles, et à soutenir sur le marché le cours de leur importance, est devenu un travail à plein temps. Au fond, le mécanisme est d’une simplicité presque déprimante, et vaut aussi bien pour la classe politique que pour les écrivains ou les artistes qui occupent le devant de la scène (pas de différence, de ce point de vue, entre les deux Emmanuel les plus célèbres de France, Macron et Carrère) : quand toute votre énergie se dissipe dans cette frénésie de visibilité – c’est-à-dire de mise en adéquation de vous-même avec la médiocrité et la vulgarité ambiantes –, il ne vous reste plus une once de sérieux à consacrer au cœur même de votre tâche. Si vous aviez au départ un peu de poids et d’envergure, il ne résistera pas à ce broyage. Même ceux qui ne sont pas nuls se retrouvent à court ou à moyen terme nullifiés. A mes yeux, c’est l’alpha et l’oméga de ce que vous appelez « décadence intérieure des élites » : ces gens-là ne travaillent plus qu’à leur propre visibilité pornographique, hors de tout bon sens, de tout aiguillon du réel et de toute norme morale. Pour répondre à votre question, ce n’est pas le « prélude » à l’effondrement : c’est l’effondrement, ni plus ni moins. Tout simplement parce qu’une société ne peut pas tenir sans ce mouvement intérieur qui nous fait nous reconnaître – avec, cela va sans dire, toutes les réserves, toutes les réticences, toutes les demi-adhésions et les contestations possibles – dans ceux qui occupent les premières places. Je vais vous livrer un souvenir qui reste très fort en moi. Ma famille, arrivée en France au moment de l’indépendance algérienne, avait toutes sortes de raisons d’en vouloir aux hypocrisies, volte-face et mensonges gaulliens. J’ai parfois entendu des anathèmes très épicés. N’empêche que les discours du général étaient fidèlement suivis sur l’écran de nos télévisions encore balbutiantes. Imaginez-vous, aujourd’hui, une pareille coexistence de la détestation et du respect ?
CJM: D’ailleurs, les textes du Général étaient de sa propre plume, et témoignaient d’une densité d’écriture couplée à une sédimentation lente, d’une culture classique patiemment ruminée, pour emprunter la formule nietzschéenne. Ce qui n’était pas le privilège d’un seul homme, la simple évocation d’un Malraux ou d’un Mauriac suffit à le démontrer. Vous adressez à nos importants contemporains une lourde admonition : désormais perclus dans un langage communicationnel « pour happy few mondialisés » (p.130), ils ignorent tout à fait cette passion du « texte rigoureusement écrit » (p.133). Votre livre se veut-il un réquisitoire, visant à éveiller le désir d’une franche « manifestation de nausée collective » (p.80), face à cette obscène omniprésence de la langue managériale ?

Pierre Mari : Partons tout simplement de l’actualité la plus récente, et la plus brûlante : l’anniversaire de la mort de Samuel Paty. Voyez les recommandations et consignes de l’Education nationale, destinées à permettre aux enseignants d’aborder avec leurs élèves ce sinistre anniversaire : elles sont déclinées dans une langue elle-même sinistre. Elles empestent le management, ni plus ni moins : des circulaires désincarnées, à l’abri des problèmes, qui se contentent d’aligner des impératifs lunaires, des exigences désorbitées et des préconisations hors-sol. On croirait qu’elles émanent du département des ressources humaines d’une grande entreprise. Pas un élan, pas un frémissement, pas une once d’attention passionnée à ce que nous devrions défendre bec et ongles. Mais le ministère n’a pas le triste monopole de cette prose. Voyez les propos que certains responsables politiques ont tenus sur le sujet : quelle que soit l’appartenance politique, on nous répète d’un ton pénétré que les enseignants manquent d’« outils pédagogiques » et d’« accompagnement adéquat » sur ces « problématiques » douloureuses. Comme si les drames que traverse ce pays et les coups de boutoir tragiques qui lui sont régulièrement infligés étaient justiciables d’une boîte à outils. Obscénité, comme vous dites. Une obscénité qui depuis des années veut nous faire croire, envers et contre toute évidence, que des problèmes de fond peuvent être traités par des approches purement formelles et instrumentales. Toutes les « élites » d’aujourd’hui, qu’elles soient politiques, institutionnelles, administratives ou culturelles, en sont là : elles brandissent des fiches-cuisine devant l’évidence chaque jour croissante de l’effondrement. Leur langage ne peut rien étreindre et rien embrasser, vu qu’il n’est le produit, comme vous le rappelez, d’aucune sédimentation, maturation ou rumination : il n’est fait que de réactions désordonnées, sans passé ni lendemain à des stimuli. Ecrire, pour moi – ou parler d’une manière authentique et digne –, c’est d’abord être capable de considérer le réel autrement qu’un ensemble de défis à relever ou de problématiques à traiter. C’est envelopper d’un regard sérieux, passionné, le drame dont nous sommes partie prenante. Cette dramatisation fondamentale est oubliée au profit de « méthodologies » prétentieuses qui sont au langage et à l’intelligence ce que les techniques de développement personnel sont au devenir frémissant d’un individu. Mon livre est-il un réquisitoire contre cette dérive générale ? Dans les conditions qui sont désormais les nôtres, la notion même de réquisitoire ou de pamphlet n’est plus pertinente. Le public a besoin de l’un ou de l’autre quand certains scandales ou ignominies n’ont pas la visibilité nécessaire. Je postule, pour ma part, que tout le monde sait très bien à quoi s’en tenir. Chacun, avec les moyens qui sont les siens, dans un recoin de son cœur ou dans la clarté de sa conscience, a d’ores et déjà jugé et condamné ce qui nous entoure.
CJM : Votre réponse, sur la nécessaire dramatisation fondamentale, résonne étrangement avec un texte de Jean Baudrillard, qui auscultait le cadavre à la renverse contemporain selon ces termes : « Aujourd’hui plus de transcendance, mais la surface immanente de déroulement des opérations, surface lisse, opérationnelle, de la communication » (Les stratégies fatales p.72). Nous sentons tous que nous sommes pris dans un mouvement historique, de longue et lente anesthétisation. Notre révolte, aussi furieuse soit-elle, sonne silencieusement comme les hurlements dans l’espace sidéral : seul le silence fait écho. À ce propos, vous dites, « les nouveaux assaillants n’ont jamais trouvé personne à qui parler” » (En pays défait p.157). N’est-ce pas justement l’objet de votre œuvre, et de celle de tout écrivain véritable, que d’être la mauvaise conscience de son temps ? D’être l’intempestif caillou dans la chaussure de tous les « Général Blanchard » [1] de toutes les époques ?
Pierre Mari : Par le plus grand des hasards, le propos de Baudrillard que vous citez consonne avec ce qu’écrivait il y a quelques jours, sur son site, un de mes vieux amis : « Si l’on saisit à quelle profondeur de drame plonge aujourd’hui la question politique, on ne peut pas se contenter de patauger, même habilement, dans les surfaces, ni de s’émietter, même utilement, dans l’immédiat. » Cette phrase me semble imparable. Elle sanctionne ce nous voyons aujourd’hui de tous les côtés, et pas seulement en politique : des gens qui pataugent et s’ébrouent dans les surfaces, qui émiettent dans l’immédiateté ce qu’ils pourraient éventuellement avoir de corps, d’âme et d’esprit. La surface immanente, lisse, opérationnelle, est devenue l’aire de jeu universelle, la pente irrésistible, l’évidence de chaque instant. Une évidence à laquelle même les meilleurs, les plus doués, les plus prometteurs, finissent par se rallier : ils savent bien que le non-ralliement équivaudrait à l’exclusion sociale. La littérature, comme la politique, comme l’entreprise, comme l’école, a basculé du côté des surfaces. Et les promoteurs de ces surfaces – éditeurs, critiques, écrivains – ont développé depuis des années l’art de les faire passer pour profondeur et transcendance. Je vous avouerai très franchement que dans ces conditions, je ne sais plus du tout ce que peut encore l’écrivain. Mauvaise conscience ? Caillou intempestif ? Aiguillon ? Vigie ? Je me rappelle avec une pointe de nostalgie et d’attendrissement ces sujets de dissertation très généraux qu’on nous proposait en hypokhâgne : « La mission du poète est de… », « Le rôle de l’écrivain, nous dit Malraux, consiste d’abord à … », etc. On pouvait encore, non sans ridicule, s’aventurer sur ce terrain-là. L’époque restait imprégnée de littérature, le président de la République était un normalien agrégé de lettres qui avait écrit une Anthologie de la poésie française, les gens ayant fait leurs « humanités classiques » demeuraient majoritaires au sein des élites. Il était possible de disserter avec un peu de vraisemblance sociale sur le rôle et la fonction de l’écrivain. C’est devenu impensable aujourd’hui, sous le régime de confusion et de prostitution qui est le nôtre. Si vous prenez réellement au sérieux l’exigence d’écrire, vous vous condamnez à un incognito qui bénéficiera, dans le meilleur des cas, d’un petit courant de ferveur souterraine. Hypothèse arithmétique la plus favorable, vous pourrez compter sur quatre à cinq cents lecteurs, que vous aurez d’ailleurs toutes les peines du monde à conserver d’un livre à l’autre. Difficile, dans ces conditions, de discourir sur la « mission » de l’écrivain, sur son « pouvoir d’intervention », sur la « résonance » ou l’« horizon » de son travail. Mais je m’empresse de dire que ce n’est pas forcément désespérant. Tant s’en faut. Au moins, nous sommes débarrassés d’un gros paquet d’illusions lyriques et de généralités emphatiques auxquelles je n’ai jamais cru. J’aime que l’acte d’écrire soit rabattu sur lui-même, et qu’on ne le fasse pas mousser. Pour ma part, j’écris des livres, point final – et évidemment inaugural. « Bon qu’à ça », disait Beckett en réponse à une de ces enquêtes (« Pourquoi écrivez-vous ? ») qui inspiraient à ses pairs de solennelles et prétentieuses tirades. Je ne m’encombre pas l’existence avec le mot « écrivain » et ses implications, je me moque de mon « œuvre », je n’ai jamais fréquenté un quelconque « milieu » littéraire où mes « confrères » et moi disserterions gravement sur notre sort commun. Je me casse la tête pour faire tenir debout des phrases. C’est tout. Je me dis parfois que telle ou telle d’entre elles saura peut-être toucher en profondeur trois ou quatre lecteurs. Et ce minimalisme me convient très bien. S’il y a un combat taillé pour moi, c’est celui-là : l’insistance quotidienne, l’acharnement sur un point précis dont je dois venir à bout. Le reste est littérature, au plus mauvais sens du terme.
CJM : Rimbaud explorait cette même intuition – « La main à plume vaut la main à charrue. – Quel siècle à mains ! ». Il est vrai que le XXème siècle nous à rebattu les oreilles avec les théories de « l’engagement » et de l’intellectuel comme « conscience morale et critique », dont les écrits auraient valeur d’oracle. Ce même Baudrillard, en maître ironiste, s’empressait d’ajouter à cette même question : « Puisque le monde nous a été donné comme énigmatique et inintelligible, la tâche de la pensée est de le rendre, si possible, encore plus énigmatique et plus inintelligible » — voilà qui rabattait le caquet poudré de nos camarades journalistes.
Dans la dernière partie de votre livre, vous insistez sur la notion de « caractère » — « La pierre de touche fondamentale est là, le discriminant qui trône au-dessus de tous les autres » (p.185). Est-ce ici, aux confins de l’irréductibilité de l’esprit, dans ce refus volontaire de « prêter l’oreille aux séductions, intérieures ou extérieures » (p.186), que nous pouvons espérer trouver la possibilité d’une île ? (Ce titre de Houellebecq répond à vos derniers mots : « rester vivant. », titre ô combien paradoxal pour notre cher Michel.)

[ Henry de Montherlant par J.E. Blanche – 1922 ]
Propos recueillis par Camarade Henri
Notes :
[1] : « J’ai peu approché les grands chefs, dont m’éloignait la modestie de mon grade et de mes fonctions. Le seul qu’il m’ait été donné de voir, quelquefois, d’un peu plus près, fut le général Blanchard. Je garde de lui surtout le souvenir d’un homme très bien élevé. La dernière fois qu’il me fit l’honneur de m’adresser la parole, ce fut, m’ayant rencontré en Normandie après mon retour des Flandres pour me dire obligeamment : « Eh bien ! vous vous êtes vous aussi, tiré indemne de cette aventure. » La formule me parut désinvolte. » L’étrange défaite, Marc Bloch 1946 éd. Gallimard (p.57 )