
7 février 2022 par Jean Mermoz

7 février 2022 par Jean Mermoz
[ Peinture : Portrait of Fedor Dostoyevsky, Vassili Perov, 1872 ]
« Car à présent, chacun aspire à séparer sa personnalité des autres, chacun veut goûter lui-même la plénitude de la vie ; cependant, loin d’atteindre le but, tous les efforts des hommes n’aboutissent qu’à un suicide total, car, au lieu d’affirmer pleinement leur personnalité, ils tombent dans une solitude complète. En effet, en ce siècle, tous se sont fractionnés en unités. Chacun s’isole dans son trou, s’écarte des autres, se cache, lui et son bien, s’éloigne de ses semblables et les éloigne de lui. Il amasse de la richesse tout seul, se félicite de sa puissance, de son opulence ; il ignore, l’insensé, que plus il amasse plus il s’enlise dans une impuissance fatale. Car il est habitué à ne compter que sur lui-même et s’est détaché de la collectivité ; il s’est accoutumé à ne pas croire à l’entraide, à son prochain, à l’humanité et tremble seulement à l’idée de perdre sa fortune et les droits qu’elle lui confère. Partout, de nos jours, l’esprit humain commence ridiculement à perdre de vue que la véritable garantie de l’individu consiste, non dans son effort personnel isolé, mais dans la solidarité. Cet isolement terrible prendra certainement fin un jour, tous comprendront à la fois combien leur séparation mutuelle était contraire à la nature, tous s’étonneront d’être demeurés si longtemps dans les ténèbres, sans voir la lumière. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l’Homme… Mais, jusqu’alors, il faut garder l’étendard et — fût-on seul à agir — prêcher d’exemple et sortir de l’isolement pour se rapprocher de ses frères, même au risque de passer pour dément. Cela afin d’empêcher une grande idée de périr. »
Dostoïevski, Biographie du starets Zozisme in Les frères Karamazov
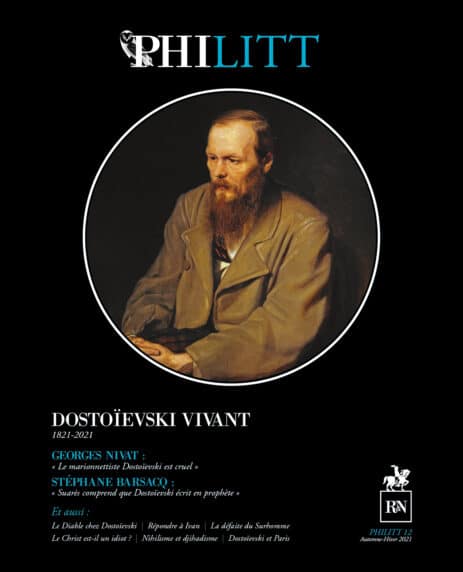 Matthieu Giroux est directeur de la rédaction de la revue PHILITT. Nous le recevons à l’occasion de la parution du douzième numéro paru aux éditions R&N : Dostoievski Vivant.
Matthieu Giroux est directeur de la rédaction de la revue PHILITT. Nous le recevons à l’occasion de la parution du douzième numéro paru aux éditions R&N : Dostoievski Vivant.
Cercle Jean Mermoz : Dans l’éditorial du dernier numéro de PHILITT, Le goût de la littérature et le goût de la vie, vous revenez sur votre découverte de Dostoïevski — « Ce fut une rencontre purement fortuite, presque un malentendu »; ainsi, vous ouvriez pour la première fois Les Possédés, « en espérant que ce Dostoïevski fût une sorte de Stoker ou de Shelley russe ». Malgré l’attente de cette fameuse histoire de possession, qui vous avait séduit lors de l’achat de l’ouvrage, vous découvrez « quelque chose de beaucoup plus important en la personne de Stavroguine »; ce personnage cristallisait pour vous le sublime paradoxe de la littérature, « Stavroguine était un personnage réel, au sens strict du terme. Il était même plus réel que le réel ». Vous revenez plusieurs fois sur cette puissance vitale du romanesque chez Dostoïevski, qui « par le biais de la fiction », nous montrerait « l’essence de la réalité ». En miroir de cette acception de la littérature, nous pensons naturellement à Proust, et son Art véritable dans Le temps retrouvé : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature.». Au-delà de Stavroguine et des Possédés, quels ont été les œuvres et les personnages de Dostoïevski qui vous ont le plus sensiblement marqués ?
Matthieu Giroux : Les grands romans de Dostoïevski sont tous constellés de personnages marquants. Ils nous touchent par leur intensité, par leur ambivalence, par leur médiocrité ou leur pureté morale. Comme vous le rappelez, je défends dans mon éditorial la thèse selon laquelle les personnages de Dostoïevski ne sont pas « réalistes » (au sens du réalisme esthétique) mais qu’ils sont la réalité même. Certains lecteurs mal avisés estiment que Dostoïevski nous confronte à des types psychologiques ou à des idées incarnées : Raskolnikov le surhomme, Stavroguine le nihiliste, Mychkine le Christ, Chatov le socialiste, Aliocha l’angelot etc. Or, si l’écrivain fait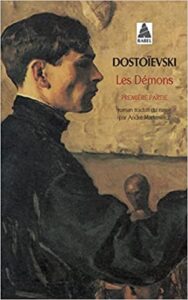 évoluer ses personnages dans un contexte historique et politique, son génie réside ailleurs. Dostoïevski parvient, grâce à son art littéraire, à nous mettre, non pas face à des militants politiques ou des défenseurs de la foi, mais face à des individus, au sens strict. Dostoïevski se soucie finalement assez peu des intrigues temporelles. Il mène un projet de dévoilement : il exhibe l’intériorité des êtres qui est le siège véritable de la réalité. En cela, il réalise un authentique exploit : je pense mieux connaître Raskolnikov ou Mychkine que mon meilleur ami.
évoluer ses personnages dans un contexte historique et politique, son génie réside ailleurs. Dostoïevski parvient, grâce à son art littéraire, à nous mettre, non pas face à des militants politiques ou des défenseurs de la foi, mais face à des individus, au sens strict. Dostoïevski se soucie finalement assez peu des intrigues temporelles. Il mène un projet de dévoilement : il exhibe l’intériorité des êtres qui est le siège véritable de la réalité. En cela, il réalise un authentique exploit : je pense mieux connaître Raskolnikov ou Mychkine que mon meilleur ami.
J’évoque tout particulièrement Les Démons dans mon éditorial car c’est par ce livre que je suis entré dans Dostoïevski. Mais, paradoxalement, je le déconseille comme première lecture. Mieux vaut commencer par Crime et châtiment qui, par sa forme, annonce le roman policier. Ou encore par L’Idiot car l’ouverture (dans le train) est captivante et parce que sa galerie de personnages est sans pareil : Mychkine, Rogojine, Nastasia Filipovna etc. Mais aussi le pauvre Hippolyte, personnage secondaire, mais qui m’a tout aussi marqué que Stavroguine. C’est un jeune phtisique qui, parce qu’il sait qu’il va mourir, comprend le caractère sacré de chaque instant de vie. Il nous met face à un paradoxe insoutenable : la valeur de la vie nous est révélée uniquement à l’approche de la mort.
.
Cercle Jean Mermoz : Vous avez d’abord envisagé Rencontre avec Dostoïevski « comme un divertissement, comme la possibilité de lire un livre sur une plage »; singulièrement cette rencontre se révélera « tout autre ». Quel est cet « autre » qui s’est dévoilé grâce à Dostoïevski ?
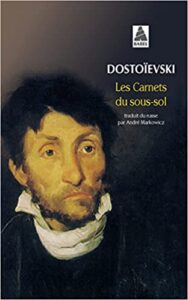 Matthieu Giroux : Je pense que c’est avec Dostoïevski que j’ai compris la différence entre la « lecture », qui relève du simple divertissement, et la « littérature » qui nous engage existentiellement. L’authentique littérature ne nous laisse jamais indemne. Je pense pouvoir dire que j’aurais été un homme différent si je n’avais jamais lu Dostoïevski. De la même manière, j’aurais été un homme différent si je n’avais pas lu Péguy dix ans plus tard. Dostoïevski initie, de manière extrêmement radicale, au caractère tragique de l’existence. La lecture de Dostoïevski équivaut à une sortie de l’innocence. Avec lui, on comprend que les hommes ne sont jamais ce qu’ils paraissent être. Il réactualise en quelque sorte certains enseignements du christianisme primitif: une prostituée peut être une sainte, « l’idiotie » peut être le stade ultime de la moralité, l’homme de tous les succès temporels peut être un démon. En bref, ne jamais sous estimer les petits !
Matthieu Giroux : Je pense que c’est avec Dostoïevski que j’ai compris la différence entre la « lecture », qui relève du simple divertissement, et la « littérature » qui nous engage existentiellement. L’authentique littérature ne nous laisse jamais indemne. Je pense pouvoir dire que j’aurais été un homme différent si je n’avais jamais lu Dostoïevski. De la même manière, j’aurais été un homme différent si je n’avais pas lu Péguy dix ans plus tard. Dostoïevski initie, de manière extrêmement radicale, au caractère tragique de l’existence. La lecture de Dostoïevski équivaut à une sortie de l’innocence. Avec lui, on comprend que les hommes ne sont jamais ce qu’ils paraissent être. Il réactualise en quelque sorte certains enseignements du christianisme primitif: une prostituée peut être une sainte, « l’idiotie » peut être le stade ultime de la moralité, l’homme de tous les succès temporels peut être un démon. En bref, ne jamais sous estimer les petits !
 Cercle Jean Mermoz : Pour vous, Dostoïevski n’est pas un « simple compagnon », au sens où il ne « nous accompagne pas seulement dans le monde, il nous montre la réalité du monde ». Pour revenir sur le titre de l’anthologie des articles de PHILITT 2014-2020, Dostoïevski est-il un compagnon de résistance face à la modernité ?
Cercle Jean Mermoz : Pour vous, Dostoïevski n’est pas un « simple compagnon », au sens où il ne « nous accompagne pas seulement dans le monde, il nous montre la réalité du monde ». Pour revenir sur le titre de l’anthologie des articles de PHILITT 2014-2020, Dostoïevski est-il un compagnon de résistance face à la modernité ?
Matthieu Giroux : Dostoïevski est un antimoderne exemplaire. Il coche quasiment toutes les cases. Il a été progressiste dans ses premiers engagements politiques (socialisme utopique) et moderne dans sa manière de renouveler l’art romanesque qu’il avait découvert chez Gogol, Balzac et Dickens. Après un épisode célèbre de sa vie – Dostoïevski est arrêté par la police politique et subit un simulacre d’exécution –, il sera ensuite réactionnaire politiquement (il estime que la figure du Tsar est indispensable au peuple russe) et antimoderne philosophiquement (il se méfie des idéologies importées d’Occident et insiste sur la singularité de la foi orthodoxe). On retrouve aussi chez lui des thèmes proprement antimodernes : critique de l’argent, du surhomme, de l’individualisme, valorisation de la foi et de l’autorité… Dostoïevski répond donc parfaitement à la définition de l’antimoderne selon Compagnon: la modernité esthétique alliée à l’antimodernité philosophique. J’aime rappeler aussi ce point essentiel: être antimoderne, c’est se méfier du monde tel qu’il est car le monde n’est pas le lieu de la vérité. En cela, Dostoïevski est un guide incontournable.
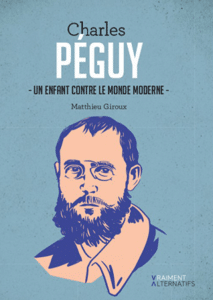 Cercle Jean Mermoz : Dans votre ouvrage Charles Péguy – un enfant contre monde moderne, vous revenez longuement sur l’incomparable vision de la modernité qu’il nous a laissée en héritage. Sur quel plan la vision de la modernité de Dostoïevski recoupe-t-elle celle de Péguy ?
Cercle Jean Mermoz : Dans votre ouvrage Charles Péguy – un enfant contre monde moderne, vous revenez longuement sur l’incomparable vision de la modernité qu’il nous a laissée en héritage. Sur quel plan la vision de la modernité de Dostoïevski recoupe-t-elle celle de Péguy ?
Matthieu Giroux : Contrairement à Péguy, Dostoïevski n’accuse pas explicitement le « monde moderne ». Si « monde moderne » il y a pour lui, il faut comprendre que c’est un monde allogène : ce sont les valeurs de l’occidentalisme, les valeurs libérales qui arrivent en Russie et qui sont symbolisées par saint Petersburg, la ville que Pierre le Grand a construit sur des marais en voulant imiter les grandes capitales européennes de l’Ouest (Paris, Londres, Vienne). Pour Dostoïevski, le monde russe, c’est-à-dire le monde slave et orthodoxe, est une force de résistance à la modernité. L’enjeu pour lui consiste donc à préserver le caractère russe de l’existence face aux influences étrangères. Ce n’est pas la même problématique chez Péguy: son «monde», c’est-à-dire celui qui a participé à la révolution industrielle et qui a vu émerger le positivisme, est devenu « moderne » par un enchaînement de décisions historiques. Si le logiciel mental du Français a changé, s’il est devenu bourgeois (pour faire court), c’est par sa propre faute. Péguy fantasme une France traditionnelle qu’il sait déjà perdue. Il en a vu les derniers soubresauts lorsqu’il était enfant. Dostoïevski, lui, est persuadé que la Russie peut encore être sauvée de la modernité, notamment en conservant son identité ethnique (slave), religieuse (orthodoxe) et politique (le tsarisme).
Cercle Jean Mermoz : Le titre de votre revue est pour le moins étonnant : Dostoïevski Vivant ; est-ce à dire qu’il était mort ?
Matthieu Giroux : Nous avons titré « Dostoïevski vivant » pour deux raisons. D’abord, pour insister sur le caractère actuel de sa pensée. Beaucoup de problématiques dostoïevskiennes sont encore les nôtres : la montée du nihilisme, la disparition de la foi, la mise à l’épreuve de la figure du Christ… Ensuite, et surtout, parce que la notion de vie est très importante chez Dostoïevski. Il a raconté comment le sens de la vie, comment son caractère sacré, lui avait été révélé après le simulacre d’exécution qu’il a subi. « Vivre », pour Dostoïevski n’est pas quelque chose d’anodin. Ce n’est pas un simple état de fait, c’est un don qu’il faut chérir passionnément. Celui qui n’embrasse pas la vie n’honore pas le message du Christ. Et vivre pour Dostoïevski, cela signifie vivre en homme libre. Celui qui ne respecte pas sa propre vie trahit la liberté et le Christ lui-même. C’est d’ailleurs une erreur fondamentale du nihilisme : croire que le suicide puisse être un acte de liberté. Un acte de mort ne peut être un acte de liberté. La vie, la liberté et le Christ sont trop étroitement liés.
Cercle Jean Mermoz : Dans un article que vous avez consacré au monumental Tolstoï et Dostoïevski de Georges Steiner, vous dites qu’à rebours « de la tyrannie powysienne, Steiner [y] substitue sa dyarchie ». Votre préférence va-t-elle vers le royalisme littéraire de Pows, le dualisme de Steiner ou ajouteriez-vous un troisième romancier pour trianguler les écrits de ces géants ?

[George Steiner]
Propos recueillis par Camarade Henri