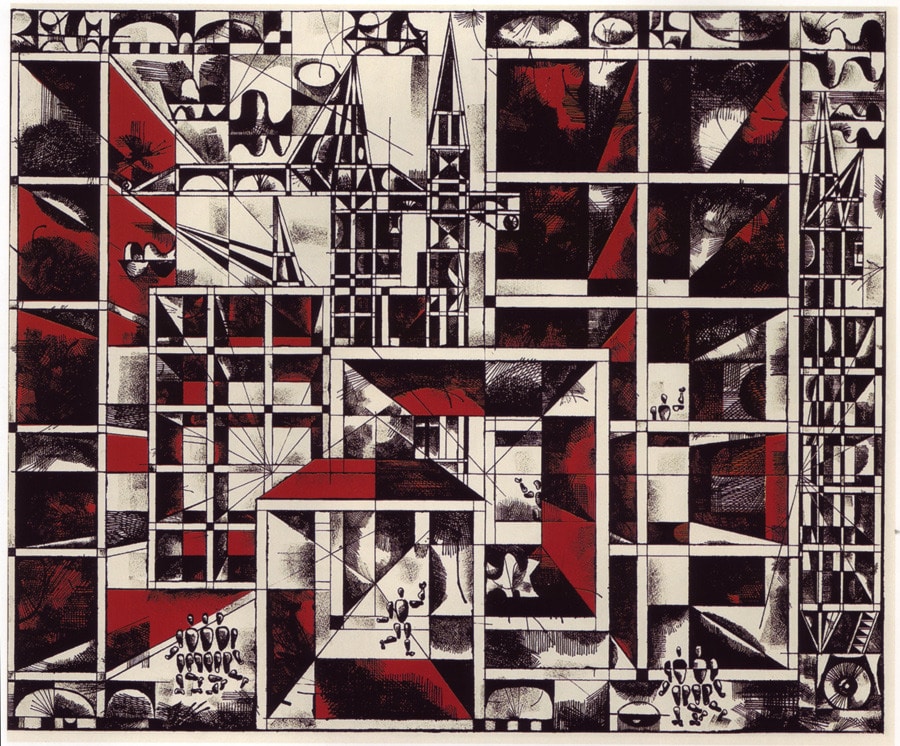L’homme et la machine
- Auteur : Nicolas Berdiaeff
- Date parution : 01/11/2019
- Difficulté : 1 / 5
- Note : 5 / 5
- ISBN : 979-10-96562-14-5
- Edition : R&N
[Article publié originellement sur le site : La vie en cube (lien ci-joint et sous l’article)]
Dans la présentation de cette merveilleuse petite collection d’ouvrages Ars Longa Vita Brevis, l’éditeur R&N indique que les textes éditées dans celle-ci « veulent aller à l’essentiel, servir d’introduction à un thème, à l’œuvre d’un auteur ou bien encore de fulgurance. » L’ouvrage de Nicolas Bediaeff, L’homme et la machine, s’inscrit pleinement dans cette lignée des courts écrits prophétiques où c’est bien à l’aune de la « fulgurance » que chaque phrase nous apparaît désormais, plus de 80 ans après sa publication originale en 1934. Alliant le talent d’un visionnaire et l’intelligence d’un observateur finement aiguisé, Berdiaeff a perçu avec une extraordinaire acuité l’essentiel des conséquences que le « machinisme » sauvage allait produire.
Berdiaeff est un existentialiste chrétien qui combine en lui-même l’héritage de Kierkegaard et l’intempestivité radicale de Dostoïevski — ce qui le rapproche de fait, comme le suggère Edouard Schaelchli dans sa formidable préface, de « [Charles] Péguy, malgré les traits qui, en lui, font penser à Joseph de Maistre ». Si l’écriture de Berdiaeff, se rapprocherait du premier par son admirable pureté, c’est pourtant bien sur l’œuvre magistrale du second qu’elle épinglerait sa métaphysique chrétienne. Emplie du regard plein d’espérance que les orthodoxes portent envers l’iconostase — cette porte incarnant symboliquement la frontière du monde divin qui, en imprégnant de milles icônes son mur sacré, rappelle aux hommes ce besoin de communion — Berdiaeff ne propose rien de moins que de conjurer l’apocalypse fatale que le machinisme nous promet, en unifiant les chrétiens autour d’une commune volonté d’exhausser « l’âme humaine au-dessus de toutes les forces sociales et cosmiques qui devront lui-être assujetties». Ainsi, en ouverture de son ouvrage, Berdiaeff dresse une typologie des différents rapports que les chrétiens russes ont eu avec la Technique : une immense majorité considère encore celle-ci comme l’appendice de l’homme — règne de l’outil fabriqué — elle est avant tout la stricte « affaire des ingénieurs ». La seconde appréhension chrétienne de la technique voit en elle « le triomphe de l’Antéchrist, la Bête monter de l’abîme ». D’un côté l’ignorance du problème, de l’autre la crainte démesurée — dans les deux cas, une préclusion paresseuse qui ignore tout à fait la singularité de la technique moderne. Si Berdiaeff voit dans la seconde option, teintée certes d’un « abus de l’Apocalypse [qui est] plus particulier à l’orthodoxie russe », elle conserve en elle ce principe de la tribulation qui, par sa nature symbolique même, est tout à la fois rempart et promontoire duquel les hommes doivent se hisser pour conjurer le désastre de la civilisation des machines. Berdiaeff se propose à travers cet opuscule, d’explorer à rebours des fantasmes démesurés et du dédain ambiant, cette « monstrueuse perversion, [au sein de laquelle l’homme] devient à nouveau esclave de ce qu’il élabore, esclave de cette machine que la société est devenue et laquelle lui-même dégénère insensiblement ».
⬧
D’une lucidité confondante, Berdiaeff démontre avec une clairvoyance remarquable que le propre de l’époque moderne réside dans une transmutation du sens de la Technique — qu’il définie comme « la façon d’obtenir un résultat au prix du moindre effort » — qui serait réévaluée par une transposition du domaine de la Finalité dans le cœur même des machines. Dépourvues jusque dans leur trognon infertile de toute téléologie autre que fonctionnelle, l’ordre des machines est celui de la production, de la construction, mais en aucun cas celui de l’édification : « par sa nature même l’outil technique est hétérogène tant à celui qui s’en sert qu’à ce à quoi il sert : il est hétérogène à l’homme, à l’esprit et au sens ». Le propre de la civilisation moderne réside pour Berdiaeff dans cette distinction de plus en plus floue qui s’installerait non pas entre les machines et les hommes, mais entre le fonctionnement des machines et celui des hommes. Par une ruse diabolique, la machine instiguerait subrepticement dans l’esprit des hommes que c’est bien à l’incandescente sécheresse de son efficacité que l’homme doit désormais chauffer son esprit moribond. La machine, incapable de dominer spirituellement les hommes, aurait ironiquement centré sa stratégie fatale sur la matérialisation effective et matérielle des miracles jusqu’alors seulement espérés par l’homme — les hommes en serait comme fascinés et, partant de là, commenceraient non pas à cultiver leur propre singularité mais à mimer l’efficacité prodigieuse des machines. Berdiaeff en dénote les premiers symptômes dès la première page de son livre : « la seule foi que l’homme de la civilisation moderne conserve est celle dont il entoure la technique, sa puissance et son progrès infini […] La technique représente le dernier amour de l’homme qui est tout prête, sous l’influence de cet amour, à modifier sa propre image » Une froide guerre intérieure s’installe, entre des machines décapitées de toute symbolique mais diaboliquement performantes et des hommes irrémédiablement empâtés. Ayant échangé leurs anciennes foi humanistes et chrétiennes contre une once métallique d’espérance, l’homme en serait fatalement venu à placer dans la Technique sa dernière chambre des miracles. Cette permutation qui intervertirait une foi gratuite, religieuse et métaphysique, avec une foi commerçante et matérielle qui aurait pour assise première la Technique et ses « miracles » n’est pas innocente. Car la technique, loin d’être uniquement une matérialisation du songes des hommes, selon l’expression d’Hannah Arendt, est avant tout, comme le dira Heidegger « une certaine manière que l’homme a de se tenir dans le monde, de se rapporter à tout ce qui l’entoure, de se représenter le réel, de considérer les choses, de les dévoiler » (1).
Berdiaeff, dès les premières pages de son court essai, s’insurge contre une définition de l’homme qui le réduirait uniquement et exclusivement à sa part fabricante et créatrice d’objet, en oblitérant totalement sa part spirituelle et métaphysique : « La définition de l’homme comme un homo faber, c’est à dire comme un être construisant des outils […] témoigne déjà de la substitution totales des fins mêmes de la vie […] L’homme est indiscutablement un ingénieur, mais il acréé son métier en vue de fins qui le transcendent ». En définissant l’Homme comme un simple homo faber, on ouvrirait la porte à un dangereux nivellement qui promeut, à rebours de sa volonté première, une égalité entre l’outil fabriqué et le fabricant, le créateur et sa création. Suivant cette définition, on en viendrait à penser la Technique non comme un « lutte », selon l’expression de Spengler (2) que Berdiaeff reprend, mais comme la finalité même de l’homme. Or, comme Berdiaeff le démontre, « Il ne peut pas y avoir de “fins” techniques de la vie, il ne peut y avoir que des “moyens” techniques. Les fins appartiennent toujours à un autre domaine, celui de l’esprit. Toutefois, les moyens s’y substituent souvent […] Et c’est ce qui se produit à notre époque dans des productions gigantesques ». Cette dangereuse substitution qu’inaugure l’ère technicienne, qui rehausse au niveau de la finalité ce qui était antiquement perçu comme une méthode, a été admirablement consignée par Hannah Arendt dans sa Condition de l’Homme moderne : « La productivité et la créativité qui devaient devenir les idéaux suprêmes, voire les idoles de l’époque moderne à ses débuts, sont des normes propres à l’homo faber, à l’homme constructeur et fabricateur. Cependant, on décèlera un autre élément, peut-être plus significatif encore, dans la version moderne de ces facultés. Le passage du «quoi» et du «pourquoi» au «comment» implique qu’en fait les objets de connaissance ne peuvent plus être des choses, ni des mouvements éternels, mais forcément des processus. […] A la place du concept d’Être nous trouvons maintenant le concept de processus » (3)Le processus folâtre sur la dépouille de la finalité perdue et l’homme se trouve enchaîné dans une gigantesque matrice du « comment » qui dévaste d’autant plus le monde qu’elle ne sait « pourquoi » elle le fait. Sous des apparences éthérée et spéculative, cette substitution de la fonction en lieu et place de l’Être est pourtant terriblement incarnée dans les usines de Taylor où l’homme — préalablement déraciné et réduit à sa part strictement fonctionnelle — se ferait à l’encontre de sa volonté, semblable aux machines : « Le système de Taylor présente une forme extrême de la rationalisation du travail, mais il ramène l’homme au rang de machine perfectionné ». L’équivalence est nettement établie : dans l’œil des machines, les ouvriers deviennent de grossiers subalternes demi-encombrants qui peinent à suivre sa diabolique cadence infernale (4). On peut tout de même noter une contradiction chez Berdiaeff : en définissant la Technique comme « la façon d’obtenir un résultat au prix du moindre effort », Berdiaeff ne remarque que c’est cette hypothèse même qui est le moteur philosophique du Taylorisme. Par voie de conséquence, même si Berdiaeff s’insurge et se scandalise à raison sur son emprise totale sur l’âme, il ne perçoit pas que c’est bien cette définition qui érige l’efficacité comme principe directeur qui est non seulement le moteur, mais l’essence même du projet taylorien.
⬧
Née du cosmos, la vie organique se définit par son autonomie propre : elle peut naître, croître et se reproduire par elle-même. La vie organisée, au contraire de la vie organique, est hétéronome ; sa loi lui est inséminée de l’extérieur : « elle résulte de l’activité de l’homme ». Voici la « thèse » fondatrice du chapitre intitulé Organisme et Organisation, où Berdiaeff replace la Technique dans une dimension historique, où la vie passerait progressivement selon lui d’un statut organiquement chaotique à un stade « organisé » et programmé.
Berdiaeff développe dans ce chapitre une intuition qui sera plus tard reprise par Heidegger, qui voudrait que la technique, par sa pro-vocation qu’elle adresse à la Nature, substitue la vie organique dans sa dimension d’extériorité fondatrice, en une pure réserve exploitable et mise à disposition : « La nouvelle réalité de la nature, que nous découvre la technique contemporaine, n’est nullement le produit de l’évolution, elle est le résultat de l’ingéniosité et de l’activité créatrice de l’homme lui-même, résultat non pas d’un processus organique, mais d’un processus organisateur ». Ce « processus organisateur » est avant tout le produit de la fusion entre la science et la technique en une pratique techno-scientifique qui aurait pour fonction première non pas de comprendre le monde comme l’antique science grecque , mais de le transformer — prométhéisme nouvellement conjugué à l’aune non plus du mythe originel, mais par la grammaire exacte de la modélisation expérimentale. Cet évolution, indissociable de l’évolution du statut que la science a subie au cours des siècles passés, Berdiaeff n’y revient pas, mais elle est pourtant essentielle pour entendre la sourde musique de ses anticipations.
Pour les grecs (5), la science n’est qu’une pure observation des phénomènes — son monde est celui du gaspillage délicat en vue de dégager des principes directeurs de la nature. La révolution épistémologique, pour user de grossiers mots, arrive avec Descartes qui, dans son Discours de la méthode, va profondément séparer non seulement la théorie de la pratique en qualifiant la science antique et médiévale de « philosophie spéculative », mais aussi conférer à la science une vertu modélisatrice par son projet totalement démiurgique, mais cependant quasi-modeste à la vue de notre époque contemporaine, de rendre l’homme « comme maître et possesseur de la nature »(6). En quittant ainsi les cryptes de l’otium contemplatif, la science est désormais sommée de rendre ses quelques maigres conclusions non seulement utiles, mais également de les constituer en « savoir actionnable », pour reprendre l’expression de Chris Argyris cité par Baptiste Rappin.(7) Ainsi, les spéculations issues d’une modélisation théorique, sont mises à contribution dans le système technicien et alimente ainsi, dans un double mouvement d’accroissement perpétuel, à la fois la connaissance du monde, et sa propre transformation. Cette dynamique d’artificialisation totale de la nature, dont Descartes a posé les premiers jalons philosophiques, est désormais visible sur l’intégralité du globe : la Technique impose, réquisitionne et reformate l’ancienne réalité organique devenue pour elle, comme l’homme chez Günther Anders, obsolète. On comprend mieux cette affirmation de Berdiaeff qui voudrait que « la nouvelle réalité qui surgit est une création de l’homme, elle résulte de l’irruption de l’esprit dans la nature et de l’insertion de la raison dans les processus cosmiques ». La scansion cosmique et immuable de l’univers organique décrite par Aristote ou Saint Thomas d’Aquin confine, pour nous autres enfants de la robotique miniaturisée, à l’archaïsme béat, voire à la fantasmagorie d’une imagination définitivement passée. La nature naturante de Spinoza a -t-elle encore un sens dans un monde techno-naturalisé où l’éclosion de la vie n’apparaît plus comme une épiphanie divine mais comme un de ses innombrables effets de processus eux mêmeintégré dans une gigantesque matrice organisationnelle ? N’est-ce pas en tout cas ce que projette Berdiaeff lorsqu’il écrit que « La technique substitue à l’élément organique irrationnel l’élément rationnel organisé […] La domination de la technique marque avant tout le passage de la vie organique à la vie organisée, le passage de la vie végétale à la vie constructive ». Ainsi, cette domination totale et planétaire serait donc en passe de créer un « ordre nouveau » indissociable du règne exclusif de la machine, qui remplacerait l’antédiluvienne nature organique par la prolifération tentaculaire de « corps organisés » purement artificiels. Ce qui — par une de ses écholalies dont seul l’esprit du temps a le secret — laisse entendre que Berdiaeff aurait pressenti des années avant Heidegger, que c’est bien en partie « l’organisation » qui serait le véhicule secret et « inapparent » du déploiement de la technique.(8)
⬧
Comme on vient de le voir, le continent technique augmente chaque jour son emprise organisatrice sur l’ancienne Pangée organique par l’utilisation sans cesse renouvelée d’une science modélisatrice. Cette transformation absolue de l’espace-terre (désormais renommé « planète » dont l’étymologie nous apprend qu’elle veut dire littéralement « astre errant » en grec ancien) s’accompagne tout naturellement de la création d’une « nouvelle réalité qui n’avait pas été prévue par la classification des sciences, et qui n’a plus aucune analogie avec la réalité mécanique ou physico-chimique ». Ce nouveau techno-cosmos qui procède d’une totale transfiguration des anciennes déterminations naturelles, Berdiaeff l’éclaire à l’aune de son approche chrétienne — nous entrevoyons ainsi l’immense gouffre béant qui s’ouvre sous nos pieds pour nous autres hommes de la modernité achevée : « Nous devons voir le sens de l’époque technique, son sens religieux, avant tout dans le fait qu’elle clôt la période tellurique de l’histoire, où l’homme était déterminé par la terre, non seulement au sens physique, mais au sens métaphysique du mot ». La Terre, ancienne figure plus ou moins centrale d’un cosmos unifié, subirait alors, du point de vue des hommes, la même révolution mentale qu’ils ont subie lors de la révolution galiléenne : elle serait annexé à son rang d’objet flottant indifférencié pris dans une multitude infinie et mouvante.
Revenons quelque peu sur les réactions engendrées par cette révolution. Blaise Pascal, ébahi de douleur et de tristesse, pleuraient déjà sur cette perte de la centralité divinement allouée à la vie humaine — « le petit espace que je remplis et même que je vois abîmé dans l’infinie immensité des espaces que j’ignore et qui m’ignorent ». Devenu une infime particule interchangeable au sein d’un univers froid et silencieux, l’homme interroge sa misère sur l’autel d’une connaissance toujours plus grande de sa propre insignifiance. Ce néant de l’âme, niché jusqu’alors dans les songeries métaphysique de l’homme qui s’endormait les yeux rivés sur l’infinité des mondes, la Technique l’enjoint à le parachever matériellement explorant « l’univers transfiguré », pour reprendre le dernier mot du livre de Berdiaeff. Cette exploration — qui procède en elle-même d’une émancipation totale de l’homme à l’endroit de toutes ses anciennes déterminations, — est certes d’une poésie infinie pour nous autres pâles observateurs des étoiles, mais nous impose de relire les interpellations que la douce voix d’Hannah Arendt lui adressait. C’est dans le prologue de son livre La condition de l’Homme moderne, qu’elle replace le lancement du premier satellite artificiel qui eu lieu en 1957 au sein d’une interrogation métaphysique qui intégrerait le devenir-artificiel de la vie humaine et ses conséquences : « L’émancipation, la laïcisation de l’époque moderne qui commença par le refus non pas de Dieu nécessairement, mais d’un dieu Père dans les cieux, doit-elle s’achever sur la répudiation plus fatale encore d’une Terre Mère de toute créature vivante ? »(9). Ce à quoi Berdiaeff, en reprenant l’eschatologie de Nicolas Féodoroff, réponderait : « La voie de la libération définitive de l’homme, de l’accomplissement de sa vocation est la voie menant au Royaume de Dieu, qui n’est pas seulement le royaume des cieux, mais aussi le royaume de la terre et de l’univers transfigurés ». Cette phrase finale de Berdiaeff est révélatrice de l’espérance qu’il place non dans la Technique, qui porte sur elle la marque méphistophélique de la défiguration du monde, mais dans la vocation chrétienne de l’Homme. Comme nous l’avons vu au début de cette note, la Technique, en substituant les moyens en lieu et place de sa propre finalité, ne peut donner aux hommes cette clé destinale qui ouvrirait le tombeau enfoui du « pourquoi ». En se refusant à une quelconque interrogation sur la finalité même de son l’entreprise, ce n’est pas son obsolescence qui guette l’Homme, mais sa profonde inanité, car comme disait Malraux, « On va sur la Lune mais si c’est pour s’y suicider, à quoi cela sert-il ? ».
⬧
Selon Berdiaeff, malgré les innombrables flétrissures dont la Technique en est la cause, il ne faut jamais perdre de vue qu’elle provient avant tout de la main de l’homme, « la puissance de la technique, qui comporte un titanisme humain, lui donna aussi le sentiment de sa propre grandeur, lui communiqua l’espérance de pouvoir dominer un jour l’univers fini ». Ne pouvant plus se blottir contre la nature, l’homme peut, selon lui, espérer dénicher une espérance au sein même du royaume de la technique. C’est d’ailleurs une des originalités de Berdiaeff que de pointer une certaine inconséquence qui accourt dans une critique de la Technique qui, en s’appuyant sur une idéalisation outrancière du passé, perdrait sa particule d’énonciation : « Mais une semblable condamnation de la technique est impuissante et ne peut être conséquemment suivie. Elle n’aboutit en définitive, qu’à la défense de ses formes arriérées sans en être la négation sociale ». En orientant le focal de sa critique uniquement sur leurs inconséquences pratiques, Berdiaeff pense pouvoir s’extraire de cette l’idéalisation du passé qu’il dénote chez Ruskin et Tolstoï. Ainsi, le monde d’autrefois se trouve tout à coup réduit sous la plume de Berdiaeff à n’être « qu’une terrible exploitation de l’homme et de l’animal, liée à l’asservissement et à l’esclavage ; nous oublions que la machine peut être un instrument de libération de cet état de servitude ». On pourrait rétorquer à Berdiaeff que son analyse est fortement biaisée par l’ablation (volontaire ?) d’une possibilité politique. Si l’émancipation de l’homme est uniquement liée à son évolution technique, alors quid de la politique ? Son destin serait alors inévitablement marqué par le fer mi-rouillé mais pleinement supérieur de la machine qui disposerait, selon sa présence ou son absence, d’un droit imprescriptible de vie ou de mort sur les hommes. Si le politique n’a eu absolument aucune conséquence dans cette émancipation, cela confirmerait, à rebours de la volonté de Berdiaeff, que le destin de la technique est consubstantiel au destin des hommes et qu’une quelconque volonté d’émancipation à l’endroit de sa domination est illusoire.
⬧
Nous parlions de Descartes, il faut signaler ici son immense modestie par l’utilisation du « comme » dans sa célèbre phrase annonciatrice de la modernité («… ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ») qu’il plaçait en garde-fou de son projet de domination de la nature. Berdiaeff, démontre que le formatage techno-scientifique moderne va infiniment plus loin que la maîtrise des espaces naturels promis par Descartes, sa domination se passe bien d’un quelconque ablatif régulateur : « La technique à une portée cosmogonique, c’est par elle que se crée un nouveau Cosmos ». Si ce projet techno-scientifique décrit par Berdiaeff arrive effectivement au bout de ses possibilités en reprogrammant l’intégralité de l’antique nature naturante en une myriade infinie de processus technique, alors la pleine artificialisation du monde sera achevée et nul ne sait si l’homme, « sera capable de vivre dans cette nouvelle réalité froide et métallique ».Le génie prophétique de Berdiaeff a été de comprendre que si la technique prenait effectivement pour l’homme l’ancienne place qui avait été assignée au cosmos, cela demanderait à l’homme une transvaluation complète de son être. La civilisation des machines ne peut coexister paisiblement avec le ferment passionnel des hommes, cette part irrationnelle teintée de fougue et d’irrationalité, d’amour et de sacrifice qui fait le cœur de l’homme — « mais la technique veut asservir cet esprit, veut le rationaliser, le transformer en automate ». Comment l’homme, créature des champs et des lacs sanctifiés par une onction bénie, pourrait-il se fondre « dans cette nouvelle réalité froide et métallique » sans devenir lui-même un automate mû, non plus par sa volonté, mais par les innombrables processus programmatiques qui le composeraient alors ? Le maigre espoir serait de penser que dans un monde totalement ravagé par le « moloch technique » pour utiliser la formule de Bernanos, l’ancienne empreinte de l’homme perdurerait sous formes de traces plus ou moins interstitielles et témoignerait de la persistance non pas de l’Homme libre, mais d’une part de son esprit. Cette continuation de l’esprit de l’Homme par d’autre moyen, Berdiaeff en esquisse les contours lorsqu’il s’étonne du fait qu’il a été plus aisé pour la Technique « de découvrir des gaz asphyxiants, que de trouver un traitement pour le cancer ou la tuberculose ». Ainsi, ce ne serait pas l’Homme pris dans sa dimension organique qui serait inaltérable, mais bien ce Mal latent et patent qui jamais n’abolira sa manifestation sur l’autel d’un quelconque perfectionnement, qu’il soit moral ou technique. Malgré toute les reconfigurations techniques du monde, malgré toutes les prothèses artificielles que l’homme se donnerait à lui-même, c’est bien le Mal qui, par son irréductibilité fondamentale, témoignerait par-delà les amoncellements de fer et d’acier, de l’ultime perduration de l’Homme — et cela, à rebours même de sa démoniaque création Machinique.
henri
Notes :
(1) Cité dans Complément au cours sur la technique : Heidegger et la question de la technique http://etiennepinat.free.fr/Complementtechnique.pdf
(2) Oswald Spengler, L’homme et la technique (R&N 2016)
(3) Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne (Pocket – Agora 1983) p.370-1
(4) Cette équivalence secrète entre l’homme et la machine qui s’installerait dans le fracas des engrenages, notre si gracieuse Simone Weil l’avait découvert avec une stupeur froide au cœur même de l’usine : « Les pièces circulent avec leurs fiches, l’indication du nom, de la forme, de la matière première ; on pourrait presque croire que ce sont elles qui sont les personnes et les ouvriers qui sont des pièces interchangeables.» Simone Weil, La Condition ouvrière (Gallimard – Folio 1951) p. 332.
(5)Platon reprend dans Le sophiste un dialogue entre Théétète et Socrate, où l’ensemble des champs du savoir se trouve comme unie dans un même moule de contemplation : « L’art du cordonnier à son tour, et toutes les techniques des autres artisans, que je les prenne en leur ensemble ou bien une par une, je n’y vois que science ». Cité par Baptiste Rappin dans Heidegger & la question du management (Ovadia 2015) p.130
(6) « Car [ces connaissances] m’ont fait voir qu’il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu’au lieu de cette philosophie spéculative, qu’on enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique, par laquelle connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n’est pas seulement à désirer pour l’invention d’une infinité d’artifices, qui feraient qu’on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. » Descartes, Discours de la méthode (Gallimard – Folio 1997) p.131
(7) Baptiste Rappin dans Heidegger & la question du management (Ovadia 2015) p.135
(8) « […], et il m’est apparu clairement que l’»organisation» relève du cœur inapparent, non pas certes de la technique, mais bien de ce à partir de quoi elle se déploie à l’aune de l’histoire de l’être ». Lettre adressée par Martin Heidegger à Hannah Arendt le 15 février 1950, cité par Baptiste Rappin. https://www.juanasensio.com/media/02/01/2510517559.pdf
(9) Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne (Pocket – Agora 1983) p.34
Article publié originellement sur le site : La vie en cube (lien ci-dessous)